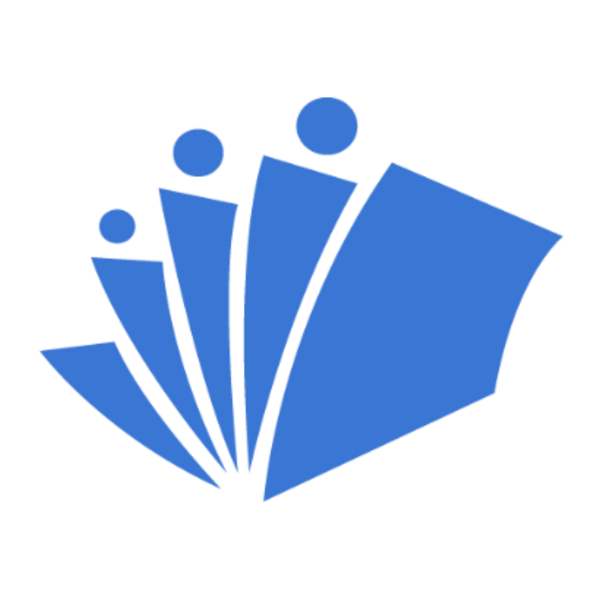L'IA va-t-elle remplacer le ghost writer ?
Depuis des siècles, les ghostwriters, ou écrivains de l’ombre, jouent un rôle discret mais fondamental dans le monde de l’écriture. Ces artisans de la plume mettent leur talent au service de ceux qui ont des idées, des histoires ou des projets, mais qui manquent du temps, des compétences ou de la confiance nécessaires pour rédiger eux-mêmes. Leur travail s’inscrit dans une tradition littéraire bien ancrée, comme en témoignent des figures telles qu’Alexandre Dumas, épaulé par Auguste Maquet pour ses grandes œuvres, ou Balzac, qui aurait parfois délégué des tâches pour respecter ses délais.
À l’instar de Colette, qui commença par écrire sous le nom de son mari Willy avant de revendiquer son indépendance, ou de Maurice Druon, qui collaborait avec des experts pour enrichir ses récits historiques, les ghostwriters ont façonné de nombreuses œuvres célèbres tout en restant dans l’ombre. Leur mission va bien au-delà de la simple rédaction : ils incarnent la voix d’autrui, traduisent des émotions, structurent des récits et répondent à des exigences spécifiques. Toutefois, leur travail exige une humilité singulière, car leur contribution demeure souvent invisible.
Historiquement, ces écrivains de l’ombre ont été qualifiés en français de "nègres", une expression profondément ancrée dans les mentalités des siècles passés. Ce terme, aujourd’hui largement rejeté pour ses connotations racistes et offensantes, évoquait à l’époque le travail invisible, souvent ingrat et mal reconnu de ces auteurs anonymes. La métaphore, bien qu’injuste et péjorative, renvoyait à l’idée de labeur et de servitude, en écho aux conditions des esclaves africains dans les colonies. Si ce vocabulaire n’est plus utilisé aujourd’hui, il reflète une perception du ghostwriting marquée par des rapports d’inégalité sociale et intellectuelle.
Aujourd’hui, l’avènement de l’intelligence artificielle (IA) bouscule cette pratique séculaire. Les outils génératifs comme ChatGPT semblent offrir une alternative prometteuse pour produire des textes rapidement et efficacement. Capables de générer des articles, des romans ou même des discours dans des styles variés, ces IA impressionnent par leur capacité à assimiler d’énormes volumes de données et à produire du contenu en quelques secondes. Leur rapidité et leur adaptabilité pourraient-elles faire de l’IA une version 2.0 des ghostwriters ?
La comparaison mérite toutefois d’être nuancée. Si les IA possèdent une efficacité redoutable, elles sont fondamentalement limitées par leur nature. Elles ne créent pas véritablement ; elles reproduisent et assemblent des modèles linguistiques en s’appuyant sur des données existantes. Contrairement aux ghostwriters humains, elles ne comprennent pas les nuances émotionnelles, ne ressentent pas d’empathie et ne peuvent adapter leur écriture en fonction de discussions approfondies avec un commanditaire.
L’IA, bien qu’impressionnante, n’offre donc pas la richesse d’un échange intellectuel ou la sensibilité d’un écrivain humain. Elle peut néanmoins s’imposer comme un outil précieux pour ces derniers. Les ghostwriters peuvent l’utiliser pour accélérer certaines étapes du processus, comme la recherche d’idées ou la structuration initiale d’un texte. Une telle collaboration homme-machine pourrait représenter l’avenir de l’écriture, où chaque partie contribue selon ses forces : la rapidité et la standardisation pour l’IA, la profondeur et l’émotion pour l’humain.
Malgré les opportunités qu’elle présente, cette révolution technologique soulève également des questions éthiques et juridiques. Qui peut revendiquer la paternité d’un texte produit par une IA ? L’utilisateur qui a fourni les instructions ou le développeur du logiciel ? Les lecteurs devraient-ils être informés que le texte qu’ils lisent a été partiellement ou entièrement rédigé par une machine ? Ces problématiques prennent d’autant plus d’importance que le ghostwriting humain, déjà entouré d’un certain mystère, repose sur des règles tacites et des contrats qui garantissent la confidentialité et la reconnaissance des rôles respectifs.
Pour ceux qui envisagent de faire appel à un ghostwriter, la démarche reste néanmoins accessible. Un projet peut être confié à un professionnel via des contacts dans l’édition ou des réseaux spécialisés. Le coût, souvent forfaitaire, varie en fonction de l’ampleur du travail. Par exemple, rédiger un livre peut coûter autour de 15 000 $ selon la complexité et la durée du projet, qui peut s’étendre sur plusieurs mois. Les conditions incluent généralement une discussion approfondie pour cerner les attentes, une clause de confidentialité et une négociation sur les droits d’auteur.
Devenir ghostwriter demande des compétences littéraires solides, une capacité à s’adapter à différentes voix et une acceptation de l’anonymat. C’est un métier exigeant, où l’humilité prime, mais il peut également être une source de revenus importante pour les écrivains. Les contacts dans le milieu et une réputation établie facilitent grandement l’accès à ce type de missions.
En conclusion, l’IA n’est pas à proprement parler une version 2.0 des ghostwriters. Elle offre des possibilités étonnantes, mais elle n’efface pas la nécessité d’une plume humaine. Les ghostwriters conservent leur place pour les projets nécessitant une compréhension fine des émotions et des nuances. L’IA redéfinit leur rôle en introduisant des outils complémentaires qui, loin de les remplacer, élargissent leurs capacités. Ce nouvel équilibre entre tradition et technologie pourrait bien transformer durablement le monde de l’écriture, ouvrant la voie à des collaborations inédites où l’humain et la machine se complètent pour créer des œuvres toujours plus riches et variées.